Les deux enclos paroissiaux d'Ergué-Gabéric
Par Pierre Faucher
Un cimetière entouré de murs, une église aux riches retables, un ossuaire, un calvaire, une "porte triomphale"… : cette puissante originalité basse-bretonne s'appelle, depuis le milieu du XIXème siècle, L'ENCLOS PAROISSIAL, que l'on découvre dans toute sa splendeur à Guimiliau ou à Pleyben par exemple.
Cet ensemble constitue à la fois un espace architectural et un espace sacré.
1. Généralités sur les enclos paroissiaux
Les enclos paroissiaux présentent les éléments suivants autour et dans l'église :
· Le baptistère (fonds baptismaux) installé à l'entrée de l'église, parfois richement décoré.
· L'ossuaire: jusqu'au 18èmesiècle, l'usage était d'inhumer les morts dans l'église. On transférait les ossements dans l'ossuaire lorsque la place manquait dans l'église. Puis le cimetière s'est installé autour de l'église, et enfin à l'écart, au début du 20èmesiècle.
· Les échaliers: les ouvertures de l'enclos sont obstruées par une marche et par une pierre plate dressée sur le chant, empêchant l'entrée du bétail. Ainsi est souligné le passage du profane au sacré.
· Le porche sud : vestibule qui accueille les fidèles entrant dans l'église. Des scènes bibliques, des statues les préparent à la messe.
· Les retables et le vitrail dans le chœur décorent l'église ; ils rappellent souvent la Passion du Christ.
· Le placître, espace cultuel situé autour de l'église. Il fait souvent office de cimetière du 18èmeau 20èmesiècle.
· Le calvaire, situé près du porche sud, est souvent orné de scènes du Nouveau Testament.
· L'arc de triomphe: cette porte de l'enclos est supportée par des piliers. Les cortèges (baptêmes, mariages, enterrements) passent sous son arcade.
· La sacristie, accolée contre le chœur de l'église
Les enclos paroissiaux sont le reflet d'une histoire et d'une culture singulières :
· Prospérité économique des 15ème– 17èmesiècles, en particulier dans les régions toilières (Locronan, Guimiliau, Saint Thégonnec…) et maritimes.
· Vitalité religieuse stimulée par la Réforme Catholique durant cette période.
· Présence insistante de la mort dans les mentalités.
· Force d'une identité paroissiale, qui s'affiche dans les clochers, les porches, les calvaires.
2. Les deux enclos paroissiaux d'Ergué-Gabéric.
Bien qu'éloignée des régions d'identification des "riches" enclos, la paroisse d'Ergué-Gabéric a construit deux ensembles qui ont des caractéristiques proches de ces enclos.
L'église Saint Guinal, église paroissiale du Bourg, avec :
- Le mur d'enclos, comportant plusieurs échaliers.
- La porte d'entrée de l'enclos (les piliers sont en place face au portail occidental de l'église).
- Le placître, qui fut cimetière jusqu'entre les deux guerres du 20èmesiècle.
- Le porche sud, auquel on accède par un escalier.
- L’ossuaire (17èmesiècle) qui présente 4 baies en plein cintre, séparées de 3 autres identiques par une porte.
- La maîtresse-vitre de la Passion (1516), dans l'église (qui est du début du 16èmesiècle), composée
de 4 baies, s'achève par un tympan dessinant 2 fleurs de lys.
- Le retable du Rosaire est entouré d'un Ecce Homo et de Sainte Apolline.
- Et dans cette église, se trouve un orgue dû à Thomas DALLAM, placé dans un buffet orné
de peintures figurant des anges musiciens (1680), comme dans les églises des enclos paroissiaux illustres de Pleyben et de Guimiliau
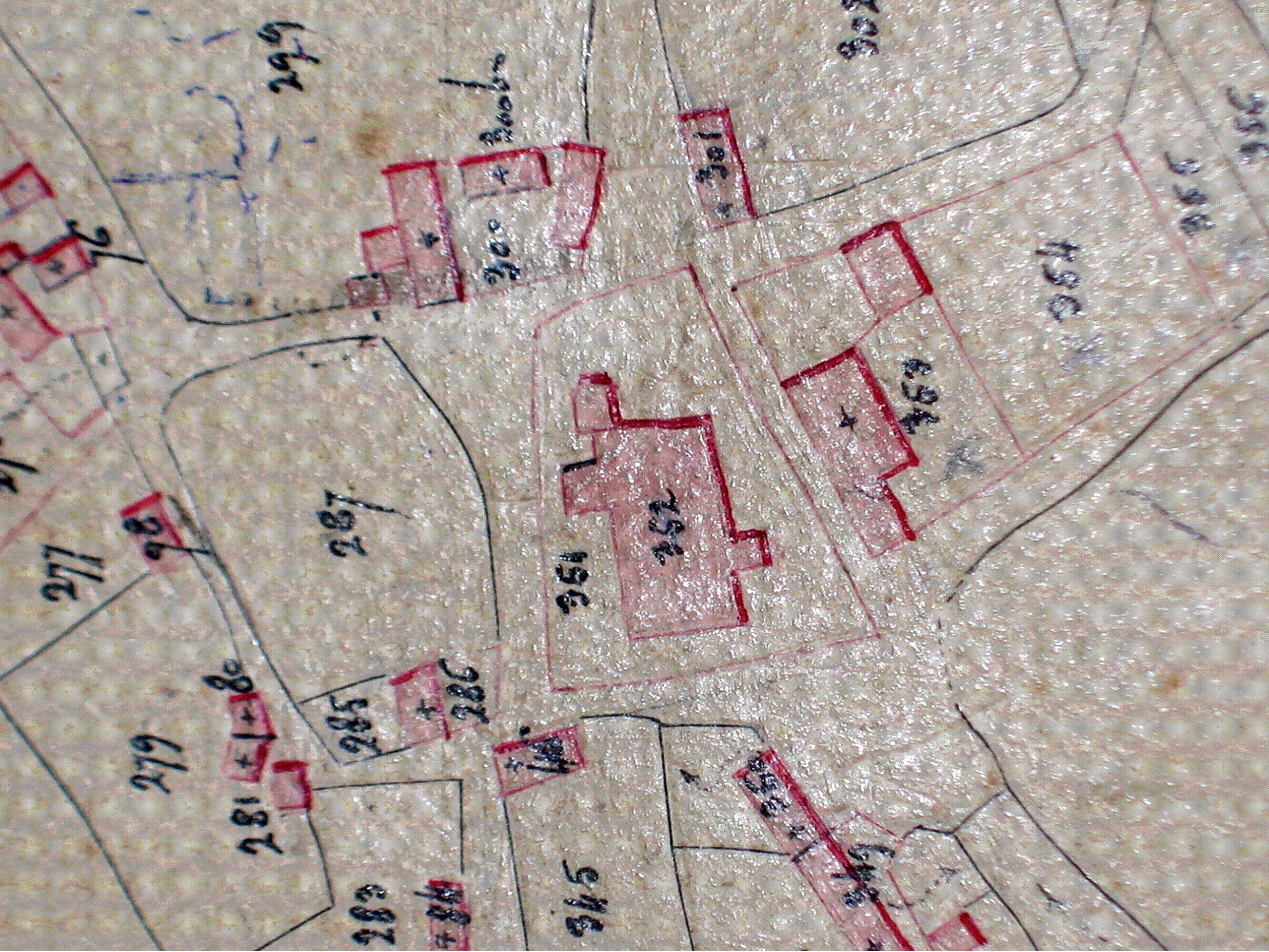
La chapelle Notre-Dame de Kerdévot, qui comporte aussi :
- Un mur d'enclos, avec des échaliers.
- Un placître, clos par les bâtiments de la ferme sur un côté, et qui ne semble pas avoir été un cimetière. Kerdévotn'est pas chapelle de trêve et ne contient pas d'ossuaire.
- La porte d'entrée de l'enclos, face à l'entrée principale (porche occidental) de la chapelle.
- La chapelle gothique du 15èmesiècle, avec sa maîtresse-vitre contenant des fragments de la vie du Christ, avec son retable sorti d'un atelier d'Anvers (scènes de la vie de la Vierge et de Jésus), d'autres retables et statues, et un calvaire intérieur. Elle comporte aussi un porche occidental avec des écus.
- La sacristie, qui offre une couverture en forme de carène.
- Le calvaire extérieur, mutilé à la Révolution, qui comprend trois croix.
Ainsi, Ergué-Gabéric se compte parmi les paroisses qui ont construit deux enclos paroissiaux. Cette particularité s'explique :
- Saint Guinal, au Bourg, est l'église paroissiale, avec son ossuaire et puis son cimetière, où l'on célèbre toutes les cérémonies importantes de la vie (baptêmes, mariages, enterrements). Cette église regroupe l'ensemble des caractères d'un enclos paroissial.
- Kerdévot, chapelle dressée en reconnaissance à la Vierge, en particulier pour l'arrêt de la peste venant d'Elliant, n'a pas les fonctions d'église paroissiale. Ainsi, les éléments de l'enclos s'en trouvent limités (pas de cimetière et d'ossuaire, pas de fonds baptismaux).
Bibliographie :
· les nombreux guides touristiques (Gallimard…)
· Le Répertoire Couffon du diocèse, "Eglises et chapelles" - 1988.
· Deux livres :"Les enclos paroissiaux de Bretagne", de Y. Pelletier. 2005.
et "Les enclos de Dieu" de G. Leclerc, 1996, Edit. Gisserot.
· Enfin, la plaquette "Kerdevot 89", éditée par Arkaé.
Vous pouvez encore consulter au Centre de Documentation Arkaé :
· "Atlas de l'histoire de Bretagne", Skol Vreiz, 2002.
· "Enclos paroissiaux", Edit. Ouest-France, 1990.
· "La Bretagne des enclos et des calvaires",
de D. Mingant et M. Decéneux, Edit. Ouest-France, 2001.
· Le "Dictionnaire du Patrimoine Breton", Editions Apogée, 2001.
C'est quoi, un placître ?
Par François Ac'h
Vous ne trouverez pas ce mot dans les dictionnaires, ni dans le Larousse, ni dans le Robert. Or, ce mot est d'usage courant en Bretagne. Il y a pratiquement un « placître » dans chaque bourg breton. Alors ?
En fait, là où en Bretagne il y a un « placître », en Auvergne il y a un « couderc », en Alsace il y a un « usoir », dans le Berry ou dans le Poitou, il y a un « queyriau »ou « querieux », bien que ces termes ne soient pas tout à fait équivalents.
La réalité concernée, c'est, au Moyen-âge, l'espace communautaire dont dispose une petite agglomération rurale (appelée « bourg » en Bretagne, « village » ailleurs). Les routes se rencontrent dans le bourg et s'élargissent en se rencontrant. Cela donne un espace libre, une sorte de terrain vague qui fait office de grand carrefour ou de plaque tournante, lieu de pacage, lieu où se tiennent les pardons, les marchés, les jeux ou les feux de la Saint Jean… On peut y trouver une fontaine, un puits ou une mare, une chapelle ou une église, peut-être un calvaire.
Ce « placître » ,dans son sens originel, a un terme correspondant en breton : c'est le « leur »:: place ou « placis » du village/bourg. Le « placître », était plutôt vaste autrefois, pas toujours matérialisé dans ses limites. Il a été peu à peu grignoté par les habitants du bourg qui se sont approprié des parcelles et y ont tracé des clôtures pour leurs jardins, courtils, échoppes.
L'église aussi était construite sur cette place commune. C'est, semble -t-il à partir des années 1630-1640 que les églises se sont entourées d'un espace clos, séparé du reste du bourg par un muret de nature à la fois à interdire l'accès du bétail et à définir une « terre sainte » autour de l'édifice religieux.
C'est cet « enclos »qui recevra plus tard les tombes des défunts, quand l'enterrement dans l'église même sera abandonné. Mais il sera en même temps une sorte de vestibule de l'église, avec un porche d'entrée, un calvaire qui peut servir de chaire à prêcher, qui déroule les scènes de l'histoire sainte…
Ainsi, le mot « placître » aurait évoqué au départ un espace public où trouvait à s'exprimer la vie quotidienne des villageois, et aurait fini par désigner prioritairement l'espace religieux, qui, par son architecture souvent riche et sa fonction particulière, s'est démarqué du reste du bourg et distingué d'un espace profane, tout en y trouvant habituellement une parfaite intégration.
En entendant « placître de Kerdevot », on peut donc aujourd'hui comprendre qu'il s'agit du grand triangle planté de platanes et de chênes, englobant à sa base la chapelle et son enclos (cf. Keleier, n° 33, rapport de "Bretagne Arborescence"). En ce sens, on dit que le marché de Kerdévot « a lieu sur le placître », que la procession « fait le tour du placître »… Et, suivant l'autre sens, plus récent, et plus restreint : le « placître », est devenu strictement l'espace clôturé autour de la chapelle, le domaine des assemblées religieuses, avec l'équipement architectural qui correspond à cette fonction. A noter que le cadastre de 1835 ne fait pas encore apparaître de mur de clôture autour de la chapelle de Kerdevot. Il aurait donc été construit ultérieurement.
Bibliographie :
· Pierre Flatrès, "les placîtres en Bretagne"Geographia polonica. 38. 1978.
· Jean-François Simon : "Le paysan breton et sa maison. T.2 La Cornouaille". Ed. de l'Estran.
Keleier Arkae 45 - juillet 2006





